La disparition en mer
Dans la nuit du 17 au 18 août 1744, une jeune fille du nom de Louise Augustine CAILLOU périt noyée dans le naufrage du Saint-Géran, à proximité de l’île d’Ambre, au nord-est de Maurice.
Le navire transportait plus de deux cents personnes à son bord : un grand nombre de marins, une dizaine de passagers originaires de l’île de France (Maurice) et de l’Île Bourbon (La Réunion) ainsi que trente esclaves embarqués lors d’une escale à Gorée.
Il est admis que plusieurs dizaines de personnes à bord étaient déjà très malades avant le naufrage ; ils pouvaient à peine se déplacer et encore moins tenter de se sauver. Leur sort était, en quelque sorte, scellé avant même le naufrage.
Selon Bertrand-François Mahé de Labourdonnais, qui était alors gouverneur des îles de France et de Bourbon, seuls neuf survivants du Saint-Géran parvinrent à rejoindre à la nage les rivages mauriciens. Tous les autres disparurent d’une façon ou d’une autre en mer.
Louise Augustine CAILLOU, jeune fille de l’île Bourbon
Parmi les disparus, figurait Louise Augustine Caillou, âgée de dix-neuf ans, qui rentrait d’un séjour en France métropolitaine, destiné à achever son éducation, certainement selon la volonté de son père.
Née à Saint-Denis le 28 juillet 1724, elle était la fille de Louis Caillou de Précourt (1696-1755), ancien flibustier belge reconverti en chirurgien-major de la marine royale, et de Catherine Panon (1702-1743), créole issue d’une illustre famille de notables de Bourbon.

Transcription :
Le vingt huitième jour du mois de juillet de l’an mil sept cent vingt quatre a été batisée Louise Augustine, fille du Sr Louis Caillou, chirurgien de la Compagnie de Catherine Panon, sa légitime épouse, née le dit jour et an que dessus. Le parrein a. été le Sr Augustin Panon et la mareine Anne Panon, femme de Jean Graciel qui ne signe point.
J’ignore encore en quelle année et sur quel navire, elle quitta son île pour la France. En revanche, les circonstances de son retour depuis Lorient en 1744 est désormais fort bien connu, et pour cause : le naufrage de son bateau, Le Saint-Géran, reste l’un des plus célèbres de l’histoire maritime de l’Océan Indien.
Sa présence à bord du narvire est attestée dans le rôle d’équipage, tout comme celle de son fiancé, Louis de MONTENDRE de LONGCHAMPS.

Le naufrage du Saint-Géran
Les témoignages de quelques survivants — Pierre TASSEL, Alain AMBROISE, Thomas CHARDROU, Jean JANVRIN et Pierre VERGER — permettent aujourd’hui de retracer les derniers instants du Saint-Géran.
Le bâtiment quitta Lorient en mars 1744, fit escale à Gorée pour embarquer des esclaves, puis reprit la mer en direction de l’île de France.
Après plusieurs mois de navigation difficile, marquée par des maladies et des décès, il approcha enfin des côtes mauriciennes au soir du 17 août 1744.
À quatre heures de l’après-midi, l’île Ronde fut aperçue. Louis de MONTENDRE de LONGCHAMPS, premier enseigne et fiancé de Louise, tenait le quart jusqu’à minuit, avant de le passer au sieur LAIR, second enseigne. Pendant la nuit, seuls quelques matelots veillaient encore.

Source : Dalībnieks, Public domain, via Wikimedia Commons
Vers trois heures du matin, les marins de l’avant aperçurent les brisants, tout proches. Le sieur LAIR ordonna de virer vent-arrière pour éviter les récifs, mais il était déjà trop tard. Le Saint-Géran talonna brutalement et fut rejeté contre les rochers.
Le choc réveilla les officiers et les passagers, qui, en chemise, se précipitèrent sur le pont. L’équipage, impuissant, pria, tandis que l’aumônier chantait des cantiques.
Un mât fut abattu dans une tentative désespérée de stabiliser le navire, mais la mer ramenait les débris sur le pont, aggravant encore la situation.
À l’aube, constatant qu’il n’y avait plus d’espoir, plusieurs hommes se jetèrent à l’eau pour tenter de gagner la côte. Le premier, le boulanger, sombra aussitôt sous le poids de son baluchon.
Quelques-uns, comme le bosseman (maître d’équipage) Pierre TASSEL, le pilotin JANVRIN et l’adjudant-canonnier VERGER, réussirent à quitter le navire. Après plusieurs heures de lutte dans l’eau, ils atteignirent l’île d’Ambre, épuisés.
Quant à Louise, elle fut aperçue pour la dernière fois sur le gaillard. Son fiancé se jeta à la mer, puis remonta aussitôt à bord pour essayer de la convaincre de sauter à son tour.
On ne sait comment Louis et Louise Augustine disparurent véritablement, les témoins dans l’eau ne s’étant plus retournés. Rien ne dit qu’ils eurent encore le temps de sauter du bateau. Ce que l’on sait en revanche, c’est que neuf survivants purent – difficilement – gagner la côte. Les deux fiancés n’étaient pas de ceux-là.
Le Saint-Géran sombra ensuite.

Source : Jules Noël, Public domain, via Wikimedia Commons.
Des procès verbaux établis sur la foi des témoins, il en résulte que ce naufrage fut moins le fruit des mauvaises conditions météorologiques que d’une succession de mauvaises décisions.
Le passage à la postérité
Séjournant quelques décennies plus tard à l’île de France, BERNARDIN de SAINT-PIERRE s’inspira largement de ce drame maritime pour écrire son roman phare Paul et Virginie. On raconte même que c’est Louise Augustine CAILLOU qui se cache derrière son héroïne Virginie de la Tour.
D’autres évoquent cependant les noms d’Anne Mallet ou de Jeanne Le Nezet, deux autres jeunes filles disparues dans le naufrage. Peut-être étaient-ce les trois à la fois ? Ou peut-être aucune ?
L’auteur s’est, de toute façon, accordé beaucoup de libertés vis-à-vis de la vérité historique ; les invraisemblances de son récit l’ont exposé, par la suite, à de très vives critiques. Il n’est pas donc impossible que Virginie de la Tour soit sortie tout droit de son imagination.
Pour ma part, je n’ai pas d’avis tranché sur la question, mais j’aime à penser qu’il subsiste quelque chose de Louise aujourd’hui, elle qui n’a laissé que très peu de traces derrière elle. J’imagine son ombre planant encore au-dessus des récifs de l’île d’Ambre, mais aussi, d’une certaine manière, dans les pages du roman Paul et Virginie pour l’éternité.

Source : BNF

Sources :
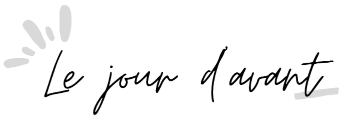




Ce texte relate une noyade tragique que tu racontes avec une émotion que l’on partage.
Je pensais que l’inspiratrice de « Paul et Virginie » était Françoise Robin, l’épouse de Pierre Poivre (c’est une tante par alliance de lointains cousins). Mais, il se peut que Bernardin se soit inspiré de plusieurs jeunes et jolies femmes.
Merci Marie pour ton commentaire, ça fait toujours très plaisir.
Je pense aussi que l’écrivain s’est inspiré de plusieurs figures féminines qu’il a connues ou pas. Quelle chance pour toi d’être apparentée à une muse ! 🙂
Pierre Poivre est très connu dans les Mascareignes, mais je n’ai pas encore fait de recherches sur lui pour l’instant. Je me note ça dans un coin de ma tête, mais je crois que nous ne sommes pas apparentés.
En passant, j’ai découvert que les enfants de Bernardin de Saint-Pierre P s’appelaient Paul et Virginie 🙂
Pouvoir se raccrocher à une oeuvre littéraire, c’est la classe ! J’en ai profité pour me cultiver un peu sur Paul et Virginie (que je n’ai pas lu) : c’est super triste cette histoire !
Je suis un descendant directe de Louis Caillou de Precourt le frere de Louise Augustine Caillou de Precourt.